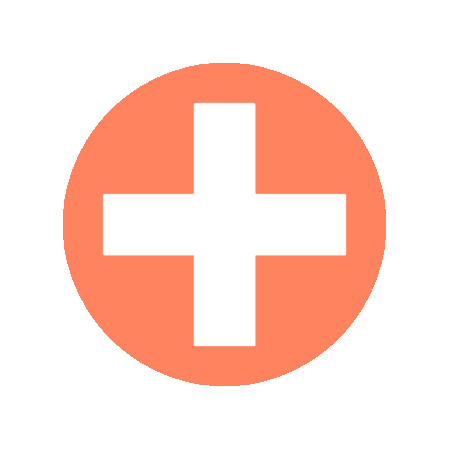Le livre Nous sommes la Nature! Écologie, colonialité et liberté des peuples, de Marcellin Nadeau, militant écologiste anticolonial martiniquais, aujourd’hui député de la Martinique, et de Pascal Margueritte, journaliste, spécialiste des dits Outre-mer et de la Caraïbe, qui côtoya Aimé Césaire, nous propose de repenser une écologie depuis la Caraïbe, une écologie décoloniale.[1]
Nous sommes la Nature! Écologie, colonialité et liberté des peuples est un ouvrage qui fusionne écologie, décolonisation et réflexion sur la souveraineté des peuples, particulièrement ceux des dits territoires d’outre-mer. Ce livre, que nous avons coécrit, est d’abord le regard d’un militant devenu maire de la petite commune du Prêcheur à l’extrême nord de l’île de la Martinique en mer des Caraïbes, puis député depuis 2022. Un militant qui a besoin de donner du sens à son action politique face à à ce qu’il vit au quotidien dans l’hémicycle parlementaire ou dans la vie politique française: une «tyrannie de l’indifférence» comme Aimé Césaire aimait à rappeler l’attitude des gouvernements occidentaux à l’égard de leurs peuples colonisés. Une «tyrannie de l’indifférence» qui tourne parfois à la tragédie, au drame de la révolte et de la répression, comme les événements récents en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Mayotte ou en Martinique l’ont montré. Mais au-delà de cette quête de sens, c’est aussi une réflexion approfondie sur les défis environnementaux et sociaux auxquels sont confrontées les Antilles françaises, mais aussi sur les pratiques écologiques à l’échelle mondiale.
L’écologie décoloniale: une écologie-monde
Nous nous inscrivons dans un courant de pensée qui part de Fanon et Césaire, en passant par le Colombien Arturo Escobar, les Martiniquais Garcin Malsa, Malcom Ferdinand, ou le mouvement mexicain zapatiste, qui est celui de l’écologie décoloniale (ou «écologitude»), une écologie qui veut regarder le monde (écologie-monde) depuis la Caraïbe, en faire un courant qui critique aussi bien le colonialisme, l’éco-colonialisme, que le «colonialisme vert», cette approche de l’écologie qui, tout en se présentant comme protectrice de la nature, occulte souvent les réalités des peuples colonisés et des territoires historiquement dominés par l’Occident (Shoshones du parc de Yellowstone aux États-Unis, Amérindiens de la forêt guyanaise ou Masaï expulsés du Serengeti au Kenya) pour permettre à des parcs nationaux protecteurs de la faune d’offrir aux touristes safaris photos et bonne conscience... Mais aussi qui englobe les luttes sociales et anticoloniales des peuples occidentaux (Mouvement des Soulèvements de la Terre, des Écureuils, des Gilets jaunes ou des paysans en France…). En contrepoint, l’écologie décoloniale proposée dans ce livre prône effectivement une réconciliation entre l’être humain et la nature, où les peuples autochtones et les populations des anciennes colonies occupent une place centrale. Ces concepts sont théorisés à partir de l’expérience politique et de terrain de Marcellin Nadeau, ancien maire du Prêcheur, qui a mené plusieurs luttes environnementales locales, contre le chlordécone ou contre le dérèglement clima-tique, par une politique municipaliste de démocratie participative visant à relocaliser la popula-tion locale menacée par la montée des eaux.
Repenser notre modèle économique
L’ouvrage explore et détaille des propositions nouvelles telles que le «désenveloppement» (opposé au développement classique axé sur la croissance économique), initié à l’origine par le géographe haïtien Georges Anglade dans son «éloge de la pauvreté», la «démobilité» (réflexion sur une société moins dépendante de la mobilité et du transport), et le «ménagement territorial» (conception alternative de l’aménagement du territoire, privilégiant la durabilité et le respect de l’environnement), la subsidiarité ou le municipalisme. Ces concepts visent à repenser notre rapport à la nature et à la modernité, en particulier dans les régions frappées par la pollution (notamment celle du chlordécone dans les Antilles) et les catastrophes écologiques liées au changement climatique. Il s’agit non pas de proposer, comme le font trop souvent les mouvements écologistes européens ou les forces progressistes, une Modernité alternative, mais une alternative à la Modernité.
L’exemple du chlordécone, un pesticide extrêmement toxique qui a contaminé les sols, les eaux et toute la chaîne alimentaire de la Guadeloupe et de la Martinique, est l’un des principaux moteurs de réflexion dans le livre. Les auteurs soulignent l’ampleur de cette catastrophe écologique et sanitaire, avec des conséquences dramatiques sur la santé des populations locales (95 % des Guadeloupéen·nes et 92 % des Martiniquais·es sont contaminé·es). L’ouvrage propose non seule-ment un diagnostic sévère mais aussi des solutions politiques et environnementales alternatives, en réponse à une forme de «tyrannie de l’indifférence» des autorités métropolitaines, qui ignorent les spécificités des îles et leur lutte pour la survie de leurs écosystèmes... Qui ignorent même leur identité de «peuples».
Cri décolonial
Mais si ce livre est un «cri» décolonial, il ne se contente pas de dénoncer, il rappelle les précédents des luttes anticoloniales depuis le début du vingtième siècle, il s’inscrit dans une histoire de la révolte et de la recherche d’identité, et il appelle à une forme originale de réparation des injustices historiques et écologiques infligées aux peuples insulaires. Il met en avant la nécessité de redonner aux peuples des Antilles leur souveraineté et leur autonomie, tant politique qu’environnementale. Dans cette optique, et en référence avec la pensée des premiers occupants des Antilles, les Amérindiens, le livre plaide pour une approche ré-enracinée de la nature où l’être humain et l’environnement sont indissociables, et où l’écologie ne se limite pas à des mesures de protection des espaces naturels, mais doit intégrer les réalités sociales, économiques et culturelles des populations locales. Ou de la ruralité.
La réflexion, si elle s’appuie sur un regard porté depuis la Caraïbe sur l’écologie, dépasse ainsi le cadre insulaire, car l’écologie décoloniale est une démarche universelle qui doit être mise en œuvre partout dans le monde. Cette perspective s’adresse à tous les peuples confrontés à l’héritage du colonialisme ou de l’oppression néolibérale et aux conséquences du dérèglement climatique. Le livre, en filigrane de la pensée marxiste ou libertaire qui considère que l’impérialisme est le stade suprême du capitalisme, développe ainsi plutôt l’idée que c’est le colo-nialisme qui est le stade suprême du capitalisme. Nous sommes la nature! se veut un cri de ralliement pour une écologie qui réconcilie l’être hu-main et la nature, loin des logiques coloniales. À travers l’expérience de ses auteurs, l’ouvrage propose des pistes concrètes pour repenser les modèles économiques et sociaux des territoires d’outre-mer et, au-delà, du monde entier. Il appelle à une prise de conscience collective sur les injustices environnementales et sociales, et à la mise en place d’une véritable écologie décoloniale, capable de restaurer la dignité et la liberté des peuples tout en protégeant la planète...
Pascal Margueritte et Marcellin Nadeau
- Le 23 novembre 2024, Primitivi, Radio Zinzine et le Local organisaient une table ronde avec Marcellin Nadeau et Pascal Margueritte qui a fourni la matière pour une émission: Écologie décoloniale en Martinique, qu’on peut écouter sur le site de la radio (http://www.zinzine.domainepublic.net/?ref=9822).