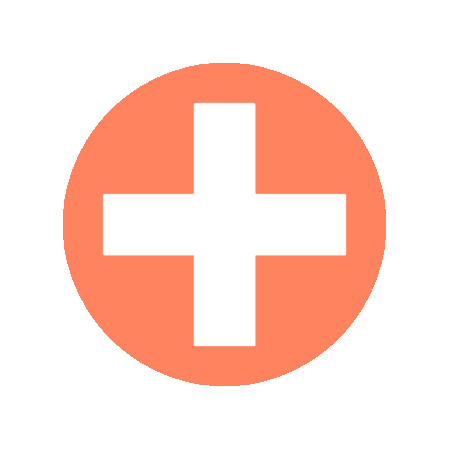Il y a 500 ans avait lieu ce qui est probablement le plus grand soulèvement de masse en Europe pour un ordre social plus juste, resté dans l’Histoire sous le nom de «guerre des paysans». À l’époque, c’est la population paysanne qui portait le poids principal du maintien de la société féodale. L’écrasement de la révolte et la poursuite de l’oppression de la paysannerie sont aujourd’hui considérés comme les prémisses du capitalisme moderne. Dans ce contexte, l’expulsion des paysan·es de leurs pâturages et de leurs forêts utilisés collectivement, les «communs», a été un élément clé. (2ème partie)
L’implantation de l’élevage pastoral en Angleterre à partir de la fin du 15e siècle est considérée comme un exemple typique de l’accumulation primitive, c’est-à-dire du vol systématique des terres. À cette époque, les propriétaires terriens britanniques ont réussi à exproprier les terres qui servaient auparavant à l’autosuffisance et à les utiliser pour l‘élevage de moutons et donc pour la production de laine dans une industrie textile en plein essor. Les terres ont été littéralement clôturées. C’est ainsi qu’est née la célèbre expression «les moutons mangent les hommes»: l’élevage ovin des grands propriétaires terriens est devenu le symbole de l’appauvrissement et de la famine d’une grande partie de la population paysanne en Angleterre. Des restrictions similaires ont également été imposées aux paysans et aux paysannes sur le continent européen à la même époque.
Florian Hurtig est auteur d’ouvrages spécialisés et agriculteur dans une ferme solidaire, c’est-à-dire une association de producteur/trices et de consommateur/trices dans le village d’Alfter, près de Bonn. Dans son livre sur les guerres paysannes, qui paraîtra prochainement, il revient en détail sur les événements de l’époque et leur signification pour notre époque: «Avec l’avènement de l’absolutisme, la situation des paysan·nes s’est progressivement détériorée, c’est-à-dire que les impôts ont augmenté. L’objectif des dirigeants était de mettre tous les paysan·nes au même niveau, à savoir celui des serfs, qui étaient les plus mal lotis. Cela s’est traduit par une augmentation des corvées, des impôts et la suppression des communaux, qui étaient par-ticulièrement importants pour les paysan·nes les plus pauvres. Tout cela a conduit à une explosion sociale et à une révolte populaire massive.»
Au printemps 1525, cette «révolte», comme l’appelaient les contemporain·es, atteignit son apogée. Pendant plusieurs mois, les paysans et paysannes révolté·es triomphèrent. L’autorité et le pouvoir s’effondrèrent, les structures familières du Saint-Empire romain germanique furent renversées, la fragilité des hiérarchies sociales et religieuses existantes apparut au grand jour. Selon l’historienne Lyndal Roper dans son ouvrage monumental sur la guerre des paysans, les gens commencèrent même à rêver d’un nouvel ordre.
Florian Hurtig constate à ce sujet: «En avril et début mai 1525, il y a eu des phases où des régions entières étaient contrôlées par des groupes de paysan·nes qui avaient de fait fondé une sorte de gouvernement local. Puis vint la Ligue souabe. Il s’agissait d‘une alliance de tous les seigneurs fonciers de la région souabe. Ils ont levé une armée, sont partis en campagne et ont progressivement écrasé les bandes de paysan·nes. Beaucoup se sont enfui·es en Suisse, où se sont formés des clubs entiers d’anciens guerriers paysans, où l’élite survivante des guerriers paysans s’est rassemblée avant de repartir en 1526 vers l’Autriche pour déclencher une nouvelle révolte.»
La création de Dieu appartient à tous Le tribut sanglant versé lors de la répression des révoltes paysannes fut énorme. Entre soixante-dix et cent mille personnes ont été massacrées par les troupes des princes. Environ un pour cent de la population de la zone de guerre mourut au cours de cet été sanglant – une perte énorme de vies humaines en quelques mois. Thomas Müntzer, le chef le plus connu des armées paysannes, fut capturé le 15 mai 1525 après la bataille de Frankenhausen en Thuringe, puis détenu et torturé dans la forteresse de Heldrungen. Le 27 mai 1525, il fut décapité aux portes de la ville de Mühlhausen, son corps et sa tête exposés à titre de dissuasion.
La vision qui animait les paysan·nes portait sur la relation de l’être humain à la création, et c’est pourquoi elle est encore pertinente aujourd’hui, écrit l’historienne Lyndal Roper. Les gens étaient en colère parce que les seigneurs revendiquaient la propriété des ressources naturelles, de l’eau, des terres communales et des forêts, alors que celles-ci appartenaient à la création de Dieu et donc à tous les humains. Ils étaient en colère parce que les seigneurs leur avaient volé leur liberté et prétendaient la posséder. Mais le Christ, comme l’a montré Luther, nous avait tous rachetés par son précieux sang.
Et aujourd’hui?
Même si aujourd’hui les luttes contre l’accaparement des terres et l’oppression ne sont généralement pas motivées par la religion, elles n’ont en aucun cas disparu à l’échelle mondiale, comme le souligne l’anthropologue culturelle et sociale Lisa Francesca Rail: «Qu’en est-il aujourd’hui? Je dirais qu’aujourd’hui encore, les paysans et les paysannes, mais aussi les autres personnes qui travaillent dans l’agriculture, c’est-à-dire les bergers et les bergères, les ouvriers agricoles, les pêcheurs et les pêcheuses, etc. sont soumis à une pression massive dans le monde entier pour pouvoir vivre de leur terre et de leur travail, c’est-à-dire pour obtenir un revenu décent, pour gagner leur vie. Et même dans les mobilisations et les luttes paysannes d’aujourd‘hui, il s’agit en général d’une révolte contre l’exploitation et la dépendance, même si ceux contre lesquels on se dresse ne sont plus des nobles féodaux».
Aujourd’hui, la contestation est généralement dirigée contre les puissantes multinationales agricoles, les groupes semenciers, les fabricants d’engrais et les chaînes de supermarchés. Dans le Sud, par exemple dans les pays d’Amérique latine, d’Afrique ou en Inde, il s’agit souvent d’une question de vie ou de mort. En Europe, la lutte pour la survie des paysan·nes est certes moins dangereuse, mais les structures du marché les mettent fortement à l’épreuve. Afin de défendre ensemble leurs intérêts, les organisations paysannes se sont regroupées au sein d’une alliance mon-diale, comme l’explique Franziskus Forster, politologue et lecteur à l’Université de la culture du sol à Vienne:
«Dans notre mouvement La Via Campesina – qui compte 200 millions de membres dans le monde et des organisations sur presque tous les continents, en Amérique latine, dans les pays africains, dans les pays asiatiques – des groupes s’unissent pour défendre ensemble l’autonomie alimentaire. C’est le droit des personnes à déterminer elles-mêmes la manière dont l’agriculture est pratiquée, la manière dont la production est réalisée, la manière dont la consommation est réalisée, la manière dont la nourriture est distribuée, en plaçant au centre les questions de l’accès à la terre, de l’accès des petit·es paysan·nes aux semences, à l’eau et à de nombreuses autres ressources élémentaires». Il est remarquable que le mouvement de critique du capitalisme de loin le plus important aujourd’hui ne vienne pas des travailleurs et travailleuses, mais des paysans et paysannes. La Via Campesina – en français «la voie paysanne» – a été fondée en 1992 et réunit des millions de petit·es paysan·nes, ouvrier·es agricoles, pêcheur·euses, sans-terre et indigènes de plus de 80 pays. Leurs revendications sont très urgentes, car le monde paysan risque de disparaître, et avec lui la biodiversité et l’approvisionnement régional, comme le souligne Lisa Francesca Rail: «Concrètement, l’exploitation des personnes travaillant dans l’agriculture se traduit aujourd’hui par un déséquilibre des rapports de force avec les industries en amont et en aval, c’est-à-dire avec les fabricants de machines, les distributeurs de semences, les entreprises de transformation telles que les laiteries ou les moulins, ou encore les supermarchés. Pour illustrer cela concrètement: s’il n’y a qu’une seule laiterie dans la région qui collecte de grandes quantités de lait cru, celle-ci peut imposer aux exploitations agricoles des normes, une fréquence de collecte et parfois même le prix, car les exploitations, en particulier celles qui produisent de grandes quantités de lait, dé-pendent de la collecte et de l’achat de ce produit périssable.» Les mouvements de résistance paysanne actuels ne visent pas à idéaliser ou à romancer la vie rurale d‘autrefois. Dans notre pays aussi, la vie dans les villages était loin d’être idyllique à bien des égards. Jusqu’aux décennies d’après-guerre, des structures patriarcales sclérosées prévalaient. Mais face à un exode rural persistant, il semble aujourd’hui plus important que jamais de rendre le travail agricole attrayant pour les jeunes et de le revaloriser. Selon Lisa Francesca Rail, cela ne pourra se faire que si le pouvoir de marché des chaînes de supermarchés est réduit. Elle ajoute: «Il en va de même lorsque, comme en Autriche, quelques grandes chaînes dominent mas-sivement le commerce alimentaire de détail. Trois groupes s’y partagent plus de 80 % du commer-ce de détail alimentaire et exercent un pouvoir considérable sur les producteur/trices.»Florian Hurtig, agriculteur en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, se rallie également à ce constat: «Le problème, bien sûr, c’est qu’aujourd’hui, on n’obtient pas les prix nécessaires pour les produits agricoles, ce qui oblige à produire en masse. En réalité, on ne peut plus vivre que des subventions, qui sont des aides à la surface. Cela signifie que ceux et celles qui ont beaucoup de terres peuvent survivre, mais pas les petit·es. Je considère que c’est le principal problème actuel: les grandes chaînes de supermarchés contrôlent tout le secteur alimentaire.»
Le dumping des prix n’a pas seulement des répercussions négatives sur les producteur/trices, mais aussi – en tant que dernier maillon et souvent le plus faible de la chaîne de production – sur les ouvrier·es agricoles, comme dans le sud de l’Espagne par exemple, où des centaines de milli-ers de travailleur·euses immigré·es privé·es de leurs droits triment sous des bâches en plastique dans la région d’Almería pour que les supermarchés puissent proposer des concombres, des poiv-rons et des tomates même en hiver.
Thomas Müntzer et les paysan·nes avec lesquel·les il avait conclu un pacte voulaient que la réforme de l’Église par Luther soit suivie d’une révolution des relations sociales. «Chrétien·nes, juif/ves, musulman·nes et païen·nes» figuraient parmi les candidat·es au salut divin selon Müntzer, qui prônait l’universalisme. Les événements de l’époque semblent aujourd’hui très lointains. Pourtant, 70 % de la production alimentaire mondiale provient encore des petit·es agricul-teur/trices. Leur survie est liée aux questions urgentes de notre époque: la protection du climat et de la biodiversité, la préservation des terres agricoles en tant que puits de carbone importants et le ralentissement de l’urbanisation. Il en va notamment de notre pain quotidien.
Alexander Behr, membre FCE-Autriche
- Cet article est la 2e partie de la transcription d’une émission de radio d’Alexander Behr intitulée «500 ans de guerres paysannes - résistance à l’accaparement des terres et à l’exploitation» de la série «Dimensions». L’émission a été diffusée le 15 avril 2025 sur la radio autrichienne Ö1.