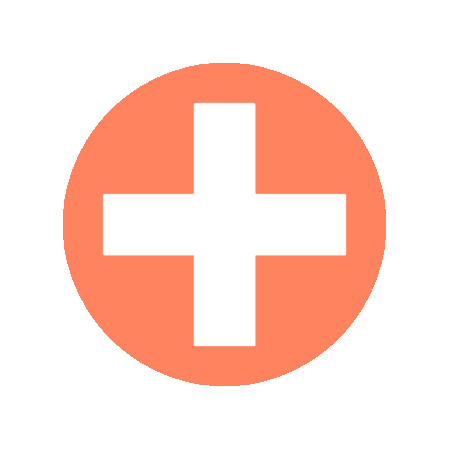Le 18 juin, nous avons organisé à Berne une conférence intitulée «Reconstruction en Ukraine - la société civile comme force de résilience». Il s’agissait de sensibiliser l’opinion publique suisse à la reconstruction en Ukraine, tout en insistant pour que le programme d’aide suisse de cinq milliards de francs pour les 11 prochaines années profite également aux initiatives de la société civile. Environ 80 personnes se sont retrouvées au centre ecclésiastique CAP à Berne pour cet événement.
D’une part, des invité·es avaient fait le déplacement depuis l’Ukraine et, d’autre part, des représentantes d’initiatives suisses actives en Ukraine y ont participé. Le mouvement coopératif Longo maï, dont le siège est à Bâle et qui est engagé depuis plus de 30 ans dans la région de Transcarpatie, était présent en tant que coorganisateur.
L’avocate ukrainienne des droits de l’homme Oleksandra Matviychuk, présidente du «Centre for Civil Liberties» (CLL) et lauréate du prix Nobel de la paix en 2022, a malheureusement dû annuler sa participation au dernier moment; elle nous a toutefois envoyé un message vidéo que nous avons diffusé en introduction à la conférence et que nous reproduisons volontiers ici in extenso. Nous souhaitons également présenter à nos lecteurs/trices des extraits d’autres interventions.
Nous devons agir maintenant!
Oleksandra Matviychuk: «Je suis avocate spécialisée dans les droits humains et c’est un honneur pour moi de pouvoir m’exprimer devant ce public. Je documente les crimes de guerre dans cette guerre que la Russie mène contre l’Ukraine. Alors que cette guerre réduit les gens à des chiffres, nous leur rendons littéralement leur nom, car les gens ne sont pas des chiffres et la vie de chacun·e compte. Cette guerre n’a pas seulement une dimension militaire, mais aussi une dimension économique. Poutine tente de briser la résistance de la population et d’occuper le pays en détruisant délibérément des habitations, des usines, des routes, des églises, des écoles, des musées et des hôpitaux. C’est pourquoi nous ne pouvons pas nous permettre de reporter la reconstruction à l’après-guerre. Nous devons agir maintenant. Et je voudrais aujourd’hui faire passer deux messages importants:
Il est nécessaire de mettre en place des projets de développement pour les communautés locales et de soutenir les entreprises locales, car celles-ci ont perdu leurs principaux actifs et installations suite à l’agression russe. Les problèmes environnementaux doivent également être abordés. Deuxièmement, afin que la reconstruction ne se limite pas à des projets de construction à grande échelle, nous devons impliquer les autorités locales et la société civile dans toutes les phases de ce processus, c’est-à-dire dans la planification, la mise en œuvre et le suivi. Nous devons former un triangle dans lequel les partenaires internationaux collaborent avec les autorités locales et la société civile au sens large, avec les entreprises locales, les organisations de la société civile, les groupes environnementaux, etc. Ce n’est qu’ensemble que nous réussirons.»
Nataliya Kabatsiy dirige depuis 25 ans l’ONG «Comité d’aide médicale en Transcarpatie» (CAMZ), qui emploie aujourd’hui 17 personnes. Celle-ci travaille dans différents domaines, mais les principaux sujets qui la préoccupaient avant la guerre étaient les droits des personnes handicapées, les droits humains en général et la migration. Elle travaille au niveau local en Transcarpatie, mais aussi au niveau supra-régional dans un vaste réseau. Elle explique au début de son intervention:
«Nous avons toujours refusé les financements de l’État en Ukraine afin de rester indépendant·es, car ici la politique veut d’une part exercer une influence et est d’autre part très changeante. Nous ne voulions pas d’étiquette politique, nous étions donc naturellement dépendant·es des fonds in-ternationaux». Le CAMZ a acquis de l’expérience, aussi bien avec différentes organisations privées étrangères qu’avec des institutions publiques en Allemagne, en France ou avec l’UE: «Nous aimons travailler avec des petites institutions, car nous pouvons ainsi réaliser des projets directement adaptés aux personnes. Avec les grandes institutions, il y a généralement de grandes lignes politiques en arrière-plan et elles agissent de haut en bas et non de bas en haut. En tant que bailleuses de fonds, elles veulent décider de la marche à suivre. Elles pensent savoir mieux que celles et ceux qui sont sur place. Or, celles et ceux qui connaissent le terrain sont les seul·es à savoir réellement ce qu’il faut. C’est la différence quand on travaille avec différents donateur/trices».
Le CAMZ coopère depuis près de 20 ans avec des institutions privées en Suisse, notamment avec le Forum Civique Européen et Longo maï. En outre, Nataliya est cofondatrice du «Réseau Suisse-Transcarpatie/ Ukraine» (NeSTU), qui a contribué à la mise en place de différents projets sociaux et culturels. Avec l’association Parasolka en Suisse, le CAMZ a pu lancer il y a 15 ans un projet pilote avec des personnes handicapées en Transcarpatie, qui est devenu un modèle positif pour toute l’Ukraine.
Nataliya aborde ensuite la question du rôle de la société civile: «Quand la guerre est arrivée, nous n’étions pas préparé·es. Mais nous étions en quelque sorte prêt·es, parce que nous sommes la société civile ukrainienne qui a toujours voulu vivre autrement. Nous ne voulions pas vivre sous des dictateurs; nous les avons envoyés en Russie. Et nous avons fait la révolution de Maïdan, pas pour rien, mais pour changer notre situation. C’est la société civile qui a accueilli les premiers réfugié·es de Crimée, de Louhansk et du Donbass en 2014, après l’annexion de la Crimée. C’est elle qui n’a jamais cessé de pousser l’État à faire des réformes. (...) Les dirigeant·es essaient souvent de faire des choses tordues, mais iels écoutent toujours s’il se passe quelque chose en bas. Iels doivent écouter la société civile, car iels savent que la révolte peut reprendre à tout moment1. Car ensemble, nous pouvons changer les choses. Et cette attitude nous a aidé·es pendant les deux premiers mois, lorsque la grande guerre a commencé.
Au début, il n’y a pas eu beaucoup d’aide internationale, parce que personne ne pensait que nous pourrions tenir. Il y avait une entraide entre les gens. (...) C’est ce qui nous a permis d’agir. Quand on parle de reconstruction, il faut toujours garder à l’esprit que ce pays est un peu différent et que la société civile a son rôle à jouer dans la reconstruction. On dit qu’on peut reconstruire l’Ukraine après la guerre, mais c’est aussi ici et maintenant. Après chaque bombardement, je reçois des appels téléphoniques de personnes qui demandent si nous pouvons les accueillir. Car nous avons trois maisons d’accueil d’urgence en Transcarpatie. Le nombre de personnes qui ont fui ne cesse d’augmenter. Chaque jour, de nouvelles villes et de nouveaux villages sont détruits. Il faut des solutions, et nous nous y attelons dès aujourd’hui. (...)
Je vais vous donner un exemple: nous travaillons depuis 20 ans avec un orphelinat qui accueille des enfants souffrant de divers handicaps. Le directeur reçoit immédiatement des appels lorsqu’un orphelinat ferme quelque part en Ukraine et que des enfants doivent partir parce que l’endroit a été touché par une bombe. Ils sont alors évacués vers la Transcarpatie. Nous-mêmes n’avons pas assez de place. Nous les accueillons provisoirement. Mais il faut tout de suite réfléchir à l’endroit où on peut les loger, dans quelle institution, à long terme.
Dans nos maisons d’accueil pour les réfugié·es de l’intérieur, il y a beaucoup de personnes âgées qui ne pourront jamais retourner dans leur village. Il faut donc réfléchir à la manière de les aider pour qu’elles puissent vivre dans la dignité. Quand j’entends que beaucoup de moyens financiers du programme d’aide suisse à l’Ukraine sont destinés à des entreprises suisses2, je comprends d’une part, car chaque pays veut soutenir sa propre économie, mais d’autre part, je dois dire que les Ukrainien·nes ont beaucoup d’idées; iels sont très innovant·es et il serait par exemple possible de les soutenir avec des microcrédits pour qu’iels puissent reconstruire leur économie et ainsi stabiliser le pays».
Quelle est la perspective?
Francesca Chukwunyere est députée au conseil municipal de Berne et l’ancienne directrice du Centre d’hébergement temporaire de Viererfeld, un quartier de Berne, qui avait été mis en place principalement pour les réfugié·es ukrainien·nes. Elle a remarqué que la composition des arrivant·es était différente de celle des groupes de réfugié·es précédents: principalement des femmes et des personnes âgées ou très âgées, mais aussi beaucoup d’enfants. Une grande partie des personnes hébergées au Viererfeld étaient des Roms qui venaient de l’ouest de l’Ukraine, donc de Transcarpatie. Lorsque le Parlement suisse a voulu supprimer le statut S pour les réfugié·es de l’ouest de l’Ukraine à l’automne 2024, Francesca Chukwunyere a décidé de se rendre sur place, dans le quartier Rom de Moukatchevo, pour se rendre compte de la situation. C’est ainsi qu’elle a découvert les projets mentionnés ci-dessus, qui sont tous de nature privée. Du côté de l’État ukrainien, elle a visité la seule maison de retraite qui existe et qui compte 200 places – pour une population de Transcarpatie qui compte désormais environ 1,2 million d’habitant·es. Un quart des résident⸱es de ce foyer sont des personnes déplacées de l’intérieur:
«Ma préoccupation en tant que directrice du centre pour personnes réfugiées à Berne a toujours été la suivante: que se passe-t-il avec les gens lorsqu’iels doivent ou veulent retourner chez eux? Les personnes âgées en particulier ne veulent guère rester ici. Mais quelle est la perspective si elles repartent? Et que se passe-t-il avec les Roms si leur statut S n’est pas prolongé ou s’iels ne peuvent plus du tout venir ici?» Francesca Chukwunyere a également visité un campement rom à Moukatchevo [3]. Environ 15.000 personnes vivaient dans ce véritable «ghetto rom» avant la guerre. Elles sont discriminées et encore plus marginalisées par la guerre.
En conclusion de la conférence, tous les intervenant·es se sont accordé·es à dire que la société civile devait jouer un rôle central dans la reconstruction. Il est recommandé à la Suisse officielle de ne pas investir les 5 milliards de francs destinés à l’Ukraine uniquement dans des entreprises suisses et dans des projets de grande envergure[4], mais de promouvoir avant tout les initiatives de la société civile. Le fait que la région de Transcarpatie ne soit pas du tout prise en compte suscite l’incompréhension. Certes, les dégâts matériels sont minimes ici, mais la région est extrêmement importante en tant que refuge pour des dizaines de milliers de personnes et lieu de résilience, et elle a besoin d’aide. La conférence a en tout cas constitué une étape importante pour une meil-leure mise en réseau entre les initiatives présentes et un plaidoyer pour une reconstruction «par le bas».
Michael Rössler, membre FCE – Suisse