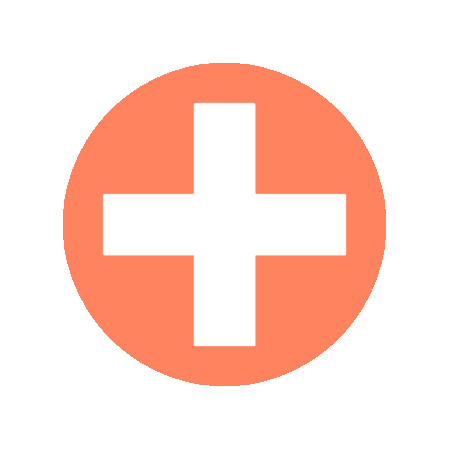Le 6 février 2014, plus de 200 personnes, parties des côtes marocaines, tentaient d’accéder à la nage à l’enclave espagnole de Ceuta. Alors qu’elles n’étaient plus qu’à quelques dizaines de mètres de la plage du Tarajal, la Guardia Civil avait utilisé du matériel antiémeute pour les empêcher d’arriver en «terre espagnole». Ni la Guardia Civil, ni les militaires marocains présents n’avaient porté secours aux personnes qui se noyaient sous leurs yeux. Quinze corps ont été retrouvés côté espagnol, des dizaines d’autres ont disparu, les survivant·es ont été refoulés, certain·es ont péri côté marocain.
Depuis, tous les ans à cette date et à l’initiative des familles de disparu·es, est célébrée ce qu’elles ont appelé une Commémor’Action[1]. Pour entretenir le souvenir de leurs proches, pour demander justice et réparation, et affirmer leur détermination à lutter pour que les politiques migratoires des pays riches cessent de tuer des milliers de personnes.
Dans le monde
Le 6 février 2024, de nombreuses villes d’Europe, d’Afrique, et jusqu’à la frontière entre les USA et le Mexique, avaient organisé une Commémor’Action. Au total, pour marquer le dixième anniversaire de la Commémor’Action, 55 événements dans 17 pays ont été répertoriés en 2024. Les naufrages, entre autres du 13 juin 2023 au large de Pylos en Grèce (plus de 600 morts) ou du 26 février 2023 au large de Cutro dans le sud de l’Italie où ont péri une centaine de personnes, ceux dans la Manche ou au large des Canaries, les disparitions dans le désert qui se comptent par milliers, engagent de plus en plus de personnes solidaires aux côtés de ces familles, et pas seulement dans les territoires frontaliers.
À Briançon
À la frontière franco-italienne dans les Alpes où 12 personnes sont mortes ou disparues depuis 2018, nous avons marqué cet anniversaire par 10 jours de débats, échanges et partages d’informations, rassemblement d’hommage, soirées théâtre et concert, et construction d’un mémorial: des centaines de personnes se sont mobilisées durant des temps différents et complémentaires. Cette cohésion des différents acteur/trices de la solidarité renforce notre détermination à faire du Briançonnais un territoire accueillant, riche de la diversité des approches et des modes d’action de ses habitant·es. C’est aussi une réponse claire aux tentatives du Maire de nous diviser en établissant une distinction entre les associations reconnues et les collectifs plus informels, entre les «bons humanitaires» et les «dangereux No Borders».
Nous pouvions aussi nourrir un nouvel espoir: le Conseil d’État et la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) venaient, par une décision du 4 février 2024 et après des années de procédures, de déclarer illégales les procédures de refus d’entrée aux frontières intérieures. Nous pensions alors voir la fin des mort·es, des blessé·es, des traumatisé·es sur notre territoire de montagne, qui devenait lui aussi, à une échelle beaucoup plus réduite, un cimetière au même titre que la mer et le désert. Et de fait, pendant près de 9 mois, les pratiques ont changé: les personnes étaient arrêtées, et relâchées après avoir donné leurs identités, pays d’origine et empreintes, même si leur droit à demander l’asile n’était toujours pas respecté, en leur refusant l’accès à un interprète, en bâclant les procédures et en ne les informant pas sur leurs droits en la matière. Nous soulignons d’ailleurs que pendant cette période, il y a eu moins de blessé·es, mais pas plus d’arrivées que les années précédentes, ce qui contredit la fameuse théorie de l’appel d’air. Et à ceux qui nous reprochent d’inciter les exilé·es à passer par Briançon au prétexte qu’il y a un accueil solidaire du territoire, nous rappelons que les passages sont aussi nombreux à Modane et Vintimille, où il n’y a pas de structure équivalente au Refuge Solidaire.
Le répit n’aura duré que quelques mois
Car c’était sans compter la volonté d’«harmonisation des pratiques», qui au lieu de faire respecter aux autres frontières intérieures les décisions du Conseil d’État et de la CJUE, a conduit les forces de l’ordre à reprendre à Briançon les refus d’entrée qui n’avaient jamais cessé aux autres points de passage. Les exilé·es sont de nouveau contraint·es de passer par des itinéraires éloignés et dangereux, de nuit et dans la neige, loin des contrôles de la Police de l’Air et des Frontières. Ce n’est pas la montagne en elle-même, ni les mauvaises conditions météorologiques, ni des prises de risques inconsidérées qui les mettent en danger, ce sont bien les pratiques des forces de l’ordre, téléguidées par des politiques migratoires de plus en plus répressives. Aujourd’hui nous craignons de nouveau des accidents, et nous avons repris les maraudes en montagne. À ce sujet, nous rappelons que nous ne faisons «passer» personne, tous ceux et celles qui arrivent ont déjà traversé le désert, la mer, ont été torturé·es, violé·es sur la route et en particulier en Lybie, ont déjà franchi bien d’autres frontières en toute autonomie, et n’ont besoin de personne pour continuer avec la force et la détermination qui les ont porté·es jusque-là. Nous appliquons les règles de réduction des risques, nous essayons de les trouver dans la montagne avant qu’iels ne meurent de froid, se perdent ou tombent d’une barre rocheuse. C’est la plus élémentaire solidarité d’un territoire, comme elle doit se pratiquer en montagne, dans le désert et en mer.
C’était sans compter non plus avec l’hostilité du maire de Briançon, qui le lendemain même de la Commémor’Action faisait voter en conseil municipal l’achat d’un véhicule 4X4 pour le mettre gracieusement à disposition de la Police de l’Air et des Frontières, comme si cette dernière manquait de moyens. Il décide donc de consacrer une partie des finances municipales à la «protection» de la frontière alors qu’elle ne traverse même pas le territoire communal. Pourtant, chaque fois que nous le sollicitons, il nous rappelle que la politique migratoire et l’hébergement d’urgence relèvent uniquement de la compétence de l’État. Le Mémorial, construit à proximité du pont d’Asfeld qui enjambe la Durance où s’était noyé le dernier disparu, a été visité, fleuri, défendu par de très nombreuses personnes[2]. C’était un cairn, petite pyramide de pierres qui sert habituellement à se repérer en montagne, surmonté d’une sculpture en bois gravée «Mémorial aux mort·es des frontières», et entouré de 12 plaques commémoratives portant les prénoms et dates de naissance et de décès de chaque personne disparue à nos portes. Au bout de deux mois, la mairie l’a fait détruire par les services techniques, au prétexte que nous n’avions pas demandé d’autorisation. Que penserait-on de la destruction d’un monument aux morts par un groupe d’une quelconque obédience? Les sentiers de montagne, les bords de route sont parsemés de petits monuments en souvenir de ceux et celles qui sont décédé·es à cet endroit, sans que personne ne songe à les en faire disparaître. Est-ce que certaines vies ont plus de valeur et ont droit à plus de respect que d’autres? Ou est-ce que l’inscription qui rappelle la responsabilité des États dans ces drames était trop dérangeante?
Mort·es des frontières
Nous soulignons d’ailleurs le terme mort·es des frontières, et pas seulement aux frontières, parce qu’à ceux et celles qui ont perdu la vie au cours du voyage, on pourrait ajouter les mort·es par suicide ou défaut de soins dans les centres de détention ou dans les camps aménagés pour les parquer, et toutes les victimes des crimes racistes et xénophobes. Car les discours de plus en plus décomplexés au plus haut niveau de l’État, les gouvernements européens qui laissent sciemment périr en mer ou dans le désert des milliers de personnes, qui alimentent la peur de l’«étranger» à des fins électoralistes, légitiment les agressions racistes de plus en plus violentes et participent à la montée en puissance des extrêmes droites. Il faudrait aussi mentionner tous·tes ceux et celles qui ont perdu un enfant, un frère, une mère, un ami sous leurs yeux, parfois plusieurs, et qui se retrouvent vivant·es certes, mais amputé·es de leurs proches et traumatisé·es à jamais.
Le 6 février 2025, nous reconstruirons le cairn, la sculpture en bois et les plaques commémoratives que nous avons pu conserver y seront scellées, et il sera exposé dans un lieu public où il pourra de nouveau être visité et fleuri par des centaines de personnes, de passage ou venues exprès. Car s’iels y ont laissé leur vie, ce territoire est aussi un terrain de jeu, été comme hiver, pour des centaines de vacancier·es qui franchissent allègrement la frontière plusieurs fois par jour, à ski, en VTT ou à pied, sans être aucunement inquiété·es. Au nom de quoi?
La station de Montgenèvre, fière de ses pistes transfrontalières, devrait aussi être le théâtre d’épreuves alpines lors des JO d’hiver de 2030. On attend de savoir sur quels critères la PAF choisira de contrôler telle ou telle personne pendant cette période... Ces pistes de ski et sentiers de randonnées, balisés pour les promeneur·euses, le sont aussi par des solidaires pour indiquer la bonne direction à prendre et rejoindre la vallée. Les exilé·es laissent volontairement des traces de leur passage, sous forme de vêtements «abandonnés», pour guider celles et ceux qui passeront par la suite. Les marques reconnaissables mises en place par les solidaires sont systématiquement effacées par on ne sait qui, mais inlassablement reconstituées. Et les vêtements qui semblent éparpillés sont ramassés au prétexte de «nettoyer» la montagne, non sans pester contre ces gens qui ne respectent rien. On peut le comprendre, mais ces quelques morceaux de tissu polluent beaucoup moins que les 4X4 et autres motoneiges utilisés par les forces de l’ordre pour traquer les exilé·es toujours plus loin et plus haut (on n’est pas loin de la devise des JO...). L’effacement de leurs traces participe plutôt, peut-être inconsciemment, à leur invisibilisation, et à rendre possible le déni des drames humains qui se jouent à nos portes.
Visibiliser la réalité
C’est bien pour cette raison que, toutes tendances confondues et unies dans un même objectif, nous continuons à héberger, soigner, recueillir des témoignages, documenter les violations de droit, intenter des recours en justice. Pour rendre visible cette réalité: les frontières tuent, et nous ne pouvons nous y résoudre. C’est le sens de la Commémor’Action, rendre hommage aux disparu·es et lutter au quotidien pour que chaque personne, d’où qu’elle vienne, puisse circuler librement à égalité avec les ressortissant·es des pays riches.
Le Briançonnais peut et doit être et rester un territoire d’accueil. Nous nous y engageons, collectivement. Le combat du village de Riace en Calabre et de son maire emblématique Mimmo Lucano, aujourd’hui député européen, nous en donne un exemple. Et les nombreux soutiens que nous recevons nous y obligent. Qu’ils en soient ici remerciés.
Anne Gautier, Tous Migrants, Médecins du Monde
- Toutes les informations sur le site <commemoraction.net>.
- Voir la tribune parue dans l’Humanité le 6 février 2024: «Hommage à celles et ceux qui ont eu le courage de fuir: ne laissons pas notre idéal européen mourir aux frontières» https://www.humanite.fr/