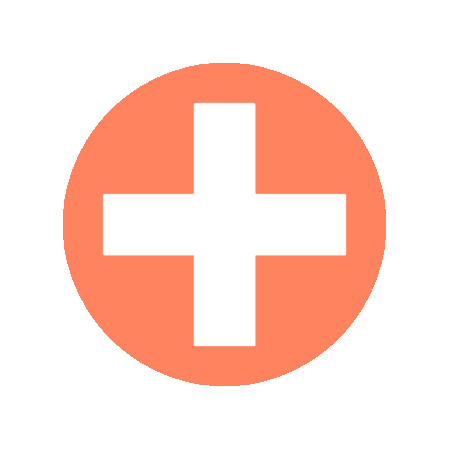Les échanges fructueux entre personnes et groupes dépassant les limites des bulles d’opinion se font rares. Les grandes plateformes numériques sont souvent plébiscitées comme premières sources d’information, tant pour rester en contact avec d’autres que pour leurs propres contenus. Vendues comme «réseaux sociaux», il s’agit pourtant de plateformes commerciales qui n’ont pas de vocation sociale et n’assument pas la responsabilité des contenus qu’elles diffusent.
Elles vivent du commerce de l’excitation et de l’exacerbation. Les contenus appelant à la con-frontation, à la haine, vecteurs de désinformation, sont récompensés par des clics. Sous couvert de liberté d’expression, leurs modèles commerciaux soutiennent cette diffusion. La sonnette d’alarme est de plus en plus souvent tirée, car cette forme de communication menace la démocratie et fait essentiellement le jeu de groupes et de partis d’extrême droite tels que l’AfD en Allemagne ou le FPÖ en Autriche. En outre, de nombreux médias autrefois sérieux entrent dans la logique de l’économie de l’excitation et rivalisent avec les plateformes ou, plutôt, entrent en symbiose avec elles.
Comment agir pour que les médias soient un véritable vecteur de démocratie? C’est sur cette question que les «Conseils citoyens Médias et Démocratie» se sont penchés au printemps 2025, réunis parallèlement en Irlande, en Autriche, en Slovénie et en République tchèque. Ils y ont exposé leurs idées et leurs exigences, et ont élaboré et adopté une série de résolutions. Dans chaque pays, le Conseil était composé d’un groupe de vingt personnes âgées de 18 à 80 ans et plus, de milieux sociaux très différents et avec des parcours de vie dissemblables. Ils se sont réunis à quatre reprises entre mars et mai 2025, sur un thème différent à chaque fois: interaction entre médias et démocratie, aperçu des systèmes médiatiques et régulation, participation et enfin représentation sociale dans les médias. Les règles de fonctionnement, la forme et les mécanismes de prise de décision étaient élaborés par les participant·es elleux-mêmes, appuyés par une équipe de professionnel·les de la modération et de l’organisation.
Qu’est-ce que la démocratie pour moi?
Dans tous les pays, les consultations ont débuté par la question suivante: «Qu’est-ce que la démocratie pour moi et quelles sont mes exigences envers les médias pour pouvoir vivre ma conception de la démocratie?». Afin d’obtenir des informations plus détaillées, les Conseils ont pu, à chaque séance, avoir recours à plusieurs expert·es. Les participant·es ont ainsi pu acquérir une connaissance approfondie des structures et des contextes, sur laquelle iels ont ensuite pu s’appuyer pour réfléchir à leurs exigences vis-à-vis des médias et de la démocratie. Les journées de consultation ont débuté par une phase d’information avec les expert·es, suivie d’une alternance de phases de consultation en petits groupes pour la formulation de propositions, de rapports, puis de discussions en séance plénière et, en fin de journée, de la phase de décision.
Les délibérations ont été marquées par le respect des différentes opinions et besoins exprimé·es, la curiosité vis-à-vis d’autres perspectives, et la volonté affirmée de formuler des réponses communes et de trouver un accord. Sur le plan thématique, les préoccupations se sont concentrées sur la promotion de la qualité des médias, le renforcement de la participation et de la représentation. L’exigence d’une meilleure éducation aux médias pour toutes les générations a été également un thème commun à tous les pays. Au cours des discussions, la question de l’urgence de l’éclatement des «bulles», dans lesquelles de plus en plus de personnes évoluent et ne sont donc plus disposées à se confronter de manière constructive à d’autres positions ou opinions a été régulièrement abordée. La pratique même des réunions a été un bon exemple que cela peut être non seulement possible, mais aussi passionnant et motivant.
Le résultat: une liste de 20 à 50 suggestions et revendications à l’attention des politicien·nes, des médias, des responsables de l’éducation, mais aussi de l’ensemble de la société. Les échanges constructifs et passionnants et l’aboutissement à des résultats communs ont été très appréciés des participant·es. Lors de la dernière rencontre, beaucoup ont confirmé qu’il était motivant de travailler ensemble sur le sujet et d’essayer de nouvelles formes d’engagement. Les étapes de ces Conseils ont été synthétisées dans de courts articles de blog1 à consulter.
Les suggestions et les exigences
En Irlande, les Conseils ont demandé, entre autres, un financement de base pour les médias communautaires non commerciaux, l’ancrage d’un salaire minimum officiel pour les journalistes, le traitement des plateformes numériques comme des médias, et la tenue de forums trimestriels où les responsables des médias et les politiciens rendraient compte de leurs activités et répondraient aux questions des citoyen·nes intéressé·es.
En Slovénie, l’accent a été mis sur l’exigence d’une plus grande transparence des structures de propriété des médias et sur le renforcement des médias non commerciaux. Il a également été demandé que les groupes sociaux défavorisés qui font l’objet d’un reportage aient toujours la possibilité de s’exprimer. Et aussi la création de programmes permettant explicitement aux représentant·es des groupes défavorisés d’accéder au journalisme et aux médias.
En République tchèque, les demandes portaient sur des mesures contre la concentration des médias, le soutien aux journalistes critiques contre les «procédures bâillon» et aux syndicats des journalistes en général, ainsi que l’adaptation à l’inflation de la redevance audiovisuelle. Toute une série de revendications ont été formulées pour soutenir le travail des médias communautaires locaux et l’implication des représentant·es des minorités dans la régulation des médias et le journalisme.
En Autriche, l’exigence de promouvoir les médias selon des critères de qualité explicites et de rendre les processus de décision également transparents a été évoquée en permanence. L’accès à des contenus médiatiques sérieux étant lié à des coûts, les personnes socialement défavorisées doivent bénéficier d’un accès gratuit et davantage de médias de qualité doivent être rendus accessibles dans les lieux publics, où sont actuellement surtout présents des journaux gratuits. La Commission européenne est invitée à plaider en faveur d’algorithmes favorisant la démocratie sur les plateformes numériques. Une particularité de l’Autriche, les contributions des expert·es ont été documentées par des graphiques.
Des événements ont été organisés dans tous les pays participants afin de présenter ces résolutions à des représentant·es des médias, du monde politique et de la société civile, et de discuter des étapes possibles de leur mise en œuvre. Les participant·es se sont accordé·es sur le fait que les Conseils citoyens devraient continuer leurs réflexions et qu’il serait urgent de mettre en place de tels conseils sur de nombreux autres sujets de société.
Les «Conseils citoyens Médias et Démocratie» font partie du projet de recherche «Mapping Media for Future Democracies (MeDeMAP)»[2]. L’association COMMIT, soutenue par le Forum Civique Européen, était responsable de la conception et de la coordination, avec pour partenaires l’Institut pour la paix en Slovénie et des institutions universitaires irlandaises et tchèques.
Helmut Peissl, FCE-Autriche, directeur de COMMIT